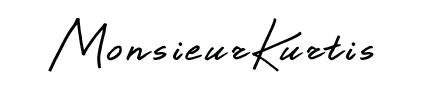Nom : Zeche Twins : une des plus grosses exploitation minière d’Allemagne Année de visite : 2024
Derrière le nom de Zeche Twins se cache l’une des plus importantes exploitations minières de charbon de toute l’histoire industrielle européenne. Son activité s’étend sur plusieurs siècles, avec des premières mentions d’extraction datant de 1446. Pourtant, ce n’est qu’en 1887 que l’histoire moderne du site débute réellement, avec la structuration de l’exploitation autour de puits majeurs. Le site va alors connaître un développement fulgurant, jalonné par des innovations techniques et des investissements considérables.

Zeche Twins : les puits
Le puits 2, foncé en 1920, marque une première étape de modernisation. Suivi en 1924-25 par le puits 3, plus modeste en taille mais salué pour son esthétique architecturale, il sera classé au patrimoine industriel. Mais c’est avec le puits 4, inauguré en 1995, que Zeche Twins entre dans une nouvelle ère. Véritable colosse de 90 mètres de haut, ce puits ultra-moderne permettait la descente rapide de personnels et matériels à des vitesses impressionnantes (jusqu’à 65 km/h). Malheureusement, la fermeture est décidée dès 1997. En 2000, la production s’arrête définitivement, après seulement cinq années d’exploitation du puits 4. Sur les photos suivantes, on peut découvrir les restes de la recette du puits 2 et un culbuteur. De jolis vestiges !


Dans les bureaux
Un peu à l’écart, on trouve une partie administrative avec plusieurs bureaux. Je ne m’y attarde pas énormément, mais j’apprécie l’aspect de chaque pièce.


Zeche Twins : Les lavoirs
Parmi les installations emblématiques, le lavoir occupe une place stratégique. C’est ici que s’opérait l’étape cruciale du traitement du charbon, visant à en extraire les impuretés et à optimiser sa valeur énergétique avant expédition. Le site était notamment réputé pour l’usage d’un système de flottation à densité contrôlée, une technologie de pointe pour l’époque. Ce procédé ingénieux permettait de séparer le minerai riche du minerai pauvre, en jouant sur leur différence de densité. Le charbon brut était immergé dans de grandes cellules de flottation remplies de magnétite, un liquide dense qui facilite la séparation : les particules les plus légères — riches en charbon — flottaient à la surface, tandis que les éléments stériles, plus lourds, coulaient au fond.
Deux zones de ces lavoirs m’ont particulièrement marqué. La première est le Drew-Boy du lavoir des puits 2 et 3 : une impressionnante roue inclinée, véritable pièce maîtresse de l’installation, dont la mécanique imposante illustre la puissance industrielle de l’époque. La seconde est le système de flottation du lavoir associé au puits 4. Graphiquement spectaculaire, avec ses cellules alignées et sa conception moderne, il se distingue nettement de celui du lavoir warning.